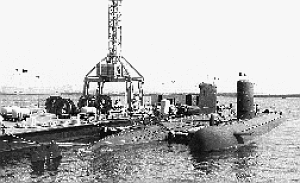Vous avez des probleme d'affichage de photos passer sur:
http://jeanlouis.ventura.free.fr
http://perso.worldonline.fr/casabianca
LES COUPURES DE JOURNAUX RELATANT LES SOUS MARINS
![]()
![]()
|
|
|
|
LORIENT (56). Une émotion perceptible mais aucun faste particulier : Lorient a vu partir hier son dernier sous-marin, la « Sirène », de type Daphné. Une page d'histoire locale s'est définitivement tournée. Avant qu'une autre - la reconversion de l'imposante base de Keroman - ne s'ouvre.
Le glas avait sonné début juillet 1995 sur l'escadrille des sous-marins de l'Atlantique (ESMAT), avec le départ pour Brest des quatre bâtiments de type Agosta (Agosta, Ouessant, Bévéziers et La Praya).
Cette fois, donc, c'en est fini de la sous-marinade à Lorient. Hier, la « Sirène » a quitté l'arsenal principal après avoir subi une ultime IPER (indisponibilité pour entretien et réparation) à la base de Keroman.
Le sous-marin participera pendant un mois à un exercice au sein de la Force d'Action Navale en effectuant deux escales (au Maroc et en Espagne) avant de rejoindre Toulon, où il sera mis en réserve pour être proposé à la vente.
Après 50 ans d'activité, l'imposante base des sous-marins de Keroman, construite par l'organisation Todt durant la seconde guerre mondiale, n'attend plus que de nouveaux locataires. Mais, c'est une autre histoire...
Avec le départ de la « Sirène », hier, une page d'histoire lorientaise s'est tournée. (Photo Claude Prigent)
|
|
|
|
|
|
|
En
France aussi, des sous-marins ont fait naufrage en toute opacité. Par JEAN-DOMINIQUE MERCHET Le lundi 23 octobre 2000 |
|
|
Les
autres jours |
![]()
|
Cinq autres accidents de sous-marins français 30 mars 1994: explosion d'une conduite de
vapeur à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude, qui parvient
à regagner Toulon. Dix morts. 20 août 1970: En surface devant Toulon, la
Galatée percute un sous-marin sud-africain. Quatre morts. 4 mars 1970: L'Eurydice disparaît en Méditerranée.
Cause inconnue. 57 morts. 25 septembre 1952: la Sybille, un ancien
sous-marin anglais, coule au large de Toulon. Cause inconnue. 46 morts. 5 décembre 1946: l'U-2326, un ancien
sous-marin allemand, disparaît en Méditerranée. 21 morts. |
|
Bien avant le naufrage du Koursk, la Marine française a, elle aussi, connu la tragédie qui guette toutes les «sous-marinades» du monde. Et pas plus que la Flotte russe, elle n'a pratiqué la transparence. Pourquoi ce sous-marin, à la pointe de la technique des années 60, a-t-il coulé ? Trente-deux ans après le drame, c'est toujours un secret défense. La Marine nationale n'a jamais rendu public le résultat de ses investigations. Les rapports de l'époque, qui dorment sur les rayonnages du service historique de la Marine, ne seront pas accessibles avant 2018, cinquante ans après les faits. Quant aux restes du submersible, jamais vraiment localisés, ils reposent toujours par 2 000 mètres de fond. Grâce aux témoignages d'anciens sous-mariniers, nous pouvons aujourd'hui reconstituer les faits et conclure que l'accident a été provoqué par une erreur de conception du sous-marin. L'un de ces marins, René Autret, est mort en mai dernier. Ancien de la Minerve, revenu à la vie civile, il gardait dans une petite sacoche tous les documents sur l'affaire. Un fonds d'archives qui serait resté confidentiel sans la décision de son fils Jean-Alain de créer un site sur l'Internet (1) et qui corrobore d'autres récits faits sous couvert de confidentialité. En sortant de la rade, cette nuit-là, la Minerve met le cap au sud-sud-est. Les grands fonds commencent aussitôt. C'est une particularité de la côte méditerranéenne à cet endroit: l'absence quasi totale de plateau continental. A peine a-t-on dépassé le cap Sicié que les bateaux se retrouvent avec 1 000 mètres d'eau sous la quille. Là où se rend la Minerve, à 12 miles nautiques (22 kilomètres) du cap, le fond est déjà à au moins 2 000 mètres. 7 h 15, exercice de lutte anti-sous-marine Lorsque le jour se lève, il fait très mauvais. Le mistral souffle du nord-ouest avec des rafales de 100 km à l'heure. La Minerve est en plongée. Dans une mer formée (force 5 à 6), c'est plus confortable pour l'équipage. En surface, un sous-marin de 800 tonnes a tendance à se comporter comme un bouchon. Rien à voir avec les sous-marins géants d'aujourd'hui, comme le Koursk, qui sont vingt fois plus lourds. La Minerve a rendez-vous avec un avion pour un exercice de lutte anti-sous-marine. Un Bréguet Atlantic, qui a décollé de la base aéronavale de Nîmes-Garons, arrive sur zone vers 7 h 15. Un premier contact radio entre l'avion et le sous-marin est établi à 7 h 19. La Minerve est en immersion périscopique. C'est-à-dire qu'il navigue suffisamment près de la surface pour qu'il puisse sortir son périscope, ses antennes radio et son schnorchel, un tube qui permet l'évacuation des gaz d'échappement et l'arrivée d'air frais (2). Son antenne est sans cesse mouillée par les vagues. Très vite, il y a de la friture sur la ligne et, à bord de l'Atlantic, le radionavigant prévient son chef - le lieutenant de vaisseau Queinnec - qu'il a des difficultés à garder le contact. A 7 h 37, le sous-marin confirme que ses difficultés de transmission sont causées par l'état de la mer. Huit minutes plus tard, l'avion revient et annonce qu'il va même annuler sa dernière vérification radar. Il est 7 h 55 lorsque le sous-marin lui répond: «Je comprends que vous annuliez cette vérification. M'avez-vous entendu?» «Je vous ai entendu», répond l'Atlantic. On n'entendra plus jamais la Minerve. Sur le moment, personne ne s'inquiète. Pendant une dizaine de minutes, l'Atlantic tente de joindre le bateau. Sans succès. Il met alors le cap sur Nîmes, convaincu que le sous-marin ne peut tout simplement plus se maintenir en immersion périscopique à cause de la tempête. Banal. A 11 heures, au moment du changement de quart au commandement des sous-marins en Méditerranée, dans le port de Toulon, un message est envoyé à la Minerve: «Annulation des exercices en raison de la météo. Vous reprenez votre liberté de manœuvre.» Pas de réponse. Mais toujours pas d'inquiétude. Des difficultés de transmission par gros temps ne surprennent personne. La technologie d'alors est plus proche de celle des U-Boot allemands de 1939-45 que des submersibles d'aujourd'hui. Clapet bloqué On attend la Minerve à Toulon pour 21 heures. Mais - c'est l'usage - le commandant a une latitude de plus ou moins quatre heures pour rentrer au port. A minuit, pas de bateau. A une heure, le délai est dépassé. A la première escadrille, le lieutenant de vaisseau Vinot prévient son chef. Il faut attendre 2 h 15, le 28 janvier, pour que la procédure «Recherche de sous-marin» soit déclenchée. Depuis le dernier contact radio avec la Minerve, dix-huit heures et vingt minutes se sont écoulées. Que s'est-il passé au petit matin du 28 janvier? Le commandant Fauve «rase les pâquerettes» en maintenant son bâtiment en immersion périscopique. Les vagues, qui noient l'antenne radio, recouvrent aussi le schnorchel. Pour éviter que l'eau de mer ne pénètre dans le sous-marin, un «clapet de tête» ferme automatiquement le tube à air chaque fois qu'une vague arrive. Un système ingénieux qui fonctionne grâce à des électrodes, mais très désagréable pour les oreilles de l'équipage. Car ces fermetures incessantes provoquent des variations de la pression atmosphérique à bord. Surpression, dépression : les tympans souffrent. Mais cette fois, en plus, le système fonctionne mal. «C'est une avarie courante» à bord des sous-marins du type de la Minerve, raconte un marin. L'eau s'engouffre dans le tube et descend directement dans la «cale aux auxiliaires». On met alors en marche une pompe pour refouler l'eau. Rien de grave, à condition que l'on parvienne à fermer le tube à air. La manœuvre est classique: un officier marinier, le «maître de centrale», tire sur une manette pour fermer la coupole. C'est ce que disent les instructions. Ce qu'elles ne disent pas, c'est ce qu'il faut faire si le flux d'eau est trop important et que la pression empêche de refermer manuellement la coupole. Ou qu'un morceau de bois flottant vienne par exemple se coincer sous la coupole. Il faudra attendre un accident similaire - cette fois-ci évité de justesse - à bord d'un sous-marin du même type, la Flore le 19 février 1971, pour que la Marine se décide à installer une grille de protection sur le clapet de tête et surtout un système hydropneumatique permettant de refermer la coupole, là où les muscles de l'équipage ne suffisaient manifestement pas. La cause de l'accident est identifiée et confirmée par un nouveau problème de fermeture de la coupole sur la Vénus. Depuis lors, plus aucun incident de schnorchel ne fut signalé sur les sous-marins du type Daphné, comme la Minerve. Ces sous-marins souffraient d'un autre problème de conception, lié à la pression dans la barre de plongée en cas de fuite. C'est ce qui permet au submersible de plonger et surtout de refaire surface... La Marine le savait et les modifications étaient d'ailleurs programmées. Mais trop tard pour la Minerve... «Ils acceptaient d'avance le sacrifice» Il ne reste qu'à imaginer l'eau qui envahit les cales et gagne le reste du bateau. Car dans ces petits sous-marins, il n'y a pas de portes étanches pour arrêter le flot. L'équipage qui tente de «chasser» tout ce qu'il peut. Très vite, le sous-marin s'alourdit et coule vraisemblablement par l'arrière. On largue les plombs de sécurité, mais la descente s'accélère. Vers 300 mètres, la coque commence à fuir: sur chaque centimètre carré, la pression est de 30 kg. A 600 mètres, l'eau a sans doute totalement envahi la Minerve. Les cinquante-deux hommes n'entendront pas les derniers craquements, lorsque la coque finira par imploser. En dépit de son jeune âge, l'équipage va laisser derrière lui dix-sept veuves et vingt-huit orphelins. Et cinquante-deux familles en deuil. L'équipage: sur la dernière photo prise à bord quelques jours avant le drame (ci-contre), on voit une bande de gamins, âgés de 20 à 25 ans, qui se serrent les uns contre les autres pour entrer dans l'objectif. Le matelot Coustal, un électricien de Narbonne, a mis des lunettes de soleil et rejeté son béret en arrière. A ses côtés, le quartier-maître mécanicien Lambert se marre. Devant lui, le quartier-maître Helmer - l'un des trois radios du bord - se tient le menton, pensif. Sans doute, songe-t-il à sa jeune épouse en Moselle. Ils sont tous volontaires pour servir dans les sous-marins, l'élite de la Marine. Beaucoup font leur service militaire. René Autret n'est pas sur la photo, il a changé d'affectation. Edmond Rabussier, non plus, n'est pas sur la photo. Mais lui embarque au dernier moment pour remplacer un matelot. C'était sa première plongée. Lancées le 28 janvier à 2 h 15, les recherches sont suspendues le matin du 2 février. Seule une nappe d'hydrocarbure est repérée dans le secteur. Il faudra attendre les années 80 pour que des détecteurs américains parviennent à repérer des morceaux d'un navire gisant par deux mille mètres de fond et répartis sur plusieurs kilomètres carrés. Ce pourrait être la Minerve. A Toulon, la Marine organise une grande cérémonie militaire et religieuse à la mémoire de l'équipage. Le général de Gaulle se déplace. Son allocution est glaçante: «Des marins sont morts en mer. Ils étaient des volontaires. C'est-à-dire qu'ils avaient d'avance accepté le sacrifice...» Circulez! A l'époque, personne ne bronche. Aujourd'hui, d'anciens marins dénoncent «la chape de plomb», le «blocage intellectuel»... «On disait que nos sous-marins étaient parfaitement sûrs en plongée. Même lorsque la Minerve disparut, cette confiance ne fut pas ébranlée», note l'un d'eux. Impossible dans la France gaullienne de mettre en cause un tel programme d'armement, «Grandeur» oblige. Les sous-marins de la classe Daphné permettaient à la Marine de se passer des anciens U-Boot allemands dont elle était équipée depuis la Libération. Avec onze bateaux, les Daphné forment alors l'ossature de la chasse sous-marine et se vendent comme des petits pains à l'étranger (Portugal, Espagne, Pakistan, Afrique du Sud). D'ailleurs, dès la fin de la cérémonie en hommage à l'équipage de la Minerve, le général de Gaulle embarque à bord d'un sous-marin du même type et s'en va plonger face à Toulon. Le bâtiment qui accueille le chef de l'Etat est l'Eurydice. Il disparaîtra à son tour au large de Saint-Tropez, le 4 mars 1970. Comme pour la Minerve, on ne connaît toujours pas officiellement les causes de cet accident. (1) (http://s.m.minerve.free.fr) (2) Le schnorchel est en usage quand les sous-marins utilisent leurs moteurs Diesel. En plongée profonde, la propulsion est assurée par des batteries électriques.
|
|
|
Retour au sommaire
Quotidien |
Nice matin du 05 janvier 2001
|
|
|
|
Paru
dans "Cols Bleus" |
|
|
L'avenir du sous-marin Par l'ingénieur Laurent Letot |
|
|
|
|
|
L'une des deux dimensions essentielles de notre stratégie de Défense est la dissuasion. Il s'agit de préserver nos intérêts vitaux contre toute atteinte en sachant exercer, en permanence et sans faille, une menace de représailles telle qu'elle fasse renoncer tout agresseur potentiel. La Marine nationale, avec ses SNLE, a déjà une longue expérience de cette mission. Leur mise en œuvre, en toute sécurité, exige de leur garantir le libre accès à la base opérationnelle, d'assurer leur sûreté à la mer et de fournir les moyens nécessaires aussi bien à la bonne exécution de leur mission qu'à leur entraînement et à leur mise en condition. La contribution est fournie par des moyens aériens, de surface et sous-marins. Le SNA y joue un rôle indispensable. Ses capacités de connaissance du milieu sous-marin et d'accumulation d'expériences sont essentielles pour garantir la sûreté des SNLE.
Le SNA joue aussi un rôle
essentiel dans l'autre dimension de notre stratégie de Défense :
l'action.
Aujourd'hui,
l'ensemble des moyens sous-marins répond convenablement aux grands axes
stratégiques définis pour notre système de défense. Quels sont les
critères qui pourraient amener à faire évoluer ou adapter nos forces
sous-marines dans leurs missions, leur format ou leurs équipements ?
L'avenir d'un système
de dissuasion repose sur sa crédibilité. Les plates-formes sous-marines
resteront encore pour longtemps la solution préférentielle tant que la
discrétion des porteurs restera crédible. Avec la nouvelle génération
de SNLE, elle atteint un niveau marquant une rupture avec la génération
précédente. Mais, même si l'évolution des moyens d'investigation du
milieu sous-marin ne laisse pas apparaître de signes de rupture, la discrétion
devra cependant être soigneusement entretenue. Indispensable interopérabilité Nous avons vu qu'une
évolution majeure concerne la nature de nos engagements, qui seront pour
la plupart, interarmées et interalliés. L'interopérabilité apparaît
donc indispensable. Sa prise en compte, déjà bien engagée, sera renforcée.
Par exemple, les liaisons automatiques de données tactiques, aujourd'hui
limitées à la seule réception, seront renforcées. Les sous-marins
d'attaque futurs disposeront de télécommunications à haut débit
assurant la fusion des donnés avec les autres plates-formes de surface et
aérienne. Il y a là une véritable révolution culturelle, qui
bouleverse quelque peu le mythe du sous-marin " corsaire "
solitaire. Un outil essentiel de défense La première plongée du Nautilus a été la concrétisation de 60 ans de recherches pour faire enfin un vrai sous-marin qui vit dans le milieu et non un submersible qui survit sous l'eau en apnée. Cette rupture en a fait, et continuera à en faire, un outil essentiel de défense. Le sous-marin stratégique devrait assez peu évoluer sinon dans sa conception, du moins dans son emploi. Quant au sous-marin nucléaire d'attaque, il se révélera certainement un outil fabuleux de contrôle de vastes espaces maritimes. C'est à ce titre qu'il aura vocation à participer de plus en plus, avec les autres composantes de la Marine, à l'ensemble des opérations de prévention et de projection dont il est devenu d'ores et déjà une pièce essentielle. |
|
Jean-Paul Nadeau
Fin de l’ultime campagne du sous-marin « Ouessant »
Pour la première fois depuis 20 ans, les deux goélettes de la Marine nationale font route vers la Méditerranée pour une grande campagne de promotion de la Royale dans les ports du Midi. Pendant qu’ils embouquaient le goulet, les voiliers ont croisé hier matin le sous-marin « Ouessant » qui rentrait de son dernier déploiement avant d’être désarmé. Entrant en rade, le sous-marin « Ouessant », de retour de la dernière campagne de sa carrière, croise les deux goélettes en partance pour la Méditerranée où elles vont passer l’été.(Photo MTS Bonnin/Marine nationale)
Après 23 ans de service, le « Ouessant », dernier sous-marin à propulsion classique (diesel-électrique) de la Marine, sera désarmé le 13 juillet et placé en réserve spéciale. Les marins espèrent qu’il sera revendu avec le « La Praya » à une marine étrangère. Il pourrait s’agir de la Malaisie qui a fait connaître son intérêt pour ces bâtiments. Deux de ses sous-mariniers ont d’ailleurs embarqué sur le « Ouessant » durant cette campagne. « Ils auront pu constater la compétitivité de notre bâtiment, notamment lors de l’exercice de lutte anti sous-marine auquel nous avons participé avec un Agosta espagnol plus récent », se félicite le CC Philippe Laurent, pacha du sous-marin. L’ultime déploiement du sous-marin d’attaque, entamé le 6 mars dernier, s’est achevé hier sans gros pépin technique, « alors que l’échéance d’IPER, c’est-à-dire la date butoir pour un grand carénage, était dépassée depuis l’été dernier en raison du désarmement fixé cette année ». Au cours de ce périple de 7.000 nautiques, les plages de repos ont été nombreuses avec pas moins de huit escales et 30 jours à quai contre 410 heures en plongée en 39 jours de mer. Les 63 sous-mariniers ont ainsi rendu visite à La Valette (Malte), Alexandrie (Egypte), Larnaka (Chypre), La Sude, Corfou (Grèce), Tarente (Italie), Carthagène et Cadix (Espagne). Cette dernière escale a donné lieu à un exercice avec la « Jeanne d’Arc » et le « Georges Leygues » en transit vers Brest.
Les goélettes parties pour cinq mois
Alors qu’il entrait en rade, le « Ouessant » a croisé « l’Etoile » et la « Belle Poule » en partance pour une longue campagne de cinq mois en Méditerranée. Salués une dernière fois par leur amiral (le CA Van Huffel qui a fait un petit bout de chemin avec eux), les deux équipages ont mis le cap sur Viana do Castello au Portugal qu’ils rallieront le 18 mai. Puis, ce sera la grande bleue avec plusieurs escales au Maroc et en Espagne, puis une petite trentaine de haltes durant tout l’été dans les ports du Golfe du Lion, de la Côte d’Azur, de Corse et d’Italie. Enfin, les deux voiliers participeront à trois événements nautiques prestigieux : Monaco Classic Week, Régates royales de Cannes et Voiles de Saint-Tropez.Fabien Roux
15/05/2001
Bonjour à tous,
Le S.M.D. "OUESSANT" en exercice d'évacuation dans la rade de Brest...
Cordialement..
Jean-Paul Nadeau ( A.G.A.A.S.M. section "Minerve" )
« On se sent comme un homme canon, comme si l’on sautait en parachute sans parachute. On n’a pas le temps d’avoir peur », a indiqué un sous-marinier parvenu à la surface.
(Photo Eugène Le Droff)
Sous-marin en détresse : l’équipage se jette à l’eau pour un exercice
Le 12 août dernier, le « Koursk » emportait par 108 mètres de fond en mer de Barents 118 sous-mariniers russes. Une tragédie que la Marine nationale ne voudrait jamais connaître. Pour cela, elle organise chaque année des exercices d’évacuation. Hier, il avait lieu en rade de Brest à partir du sous-marin « Ouessant ».11 h 50, dans une gerbe d’eau, le premier sous-marinier fait surface. Allongé sur le dos, dans sa combinaison de survie orange fluo, il lève le bras pour signaler que tout va bien. Il est immédiatement embarqué à bord d’un canot pneumatique. Direction le « Styx » (bâtiments de soutien aux plongeurs démineurs), qui mouille à proximité, où il est examiné par un médecin. Homme canon Opération réussie. Le maître sous-marinier Eric De Leeuw raconte : « C’était très rapide. Moins de dix secondes. On se sent comme un homme canon, comme si l’on sautait en parachute sans parachute. On n’a pas le temps d’avoir peur. L’appréhension, c’est plutôt avant ». Avant, c’est l’attente dans le local de survie où les 65 hommes d’équipage s’étaient regroupés. Le sous-marin d’attaque « Ouessant » simulant une grave avarie reposait par 27 mètres de fond entre l’Ile longue et la pointe des Espagnoles. Pour l’exercice, douze hommes devaient quitter le bâtiment. Les consignes sont précises. Le sous-marinier s’enferme dans un des deux sas de secours. Il le remplit d’eau et équilibre la pression d’immersion de sa combinaison. Toutes les cinq secondes, il tape sur la paroi avec un boulon pour signaler que tout va bien. Le sas s’ouvre automatiquement quand il est plein et le sous-marinier remonte à la surface « comme une bulle », sans palier de décompression ni assistance respiratoire. Cet exercice, qui a lieu chaque année, a pour but de valider en conditions réelles les procédures d’évacuation individuelle (possible jusqu’à 180 m), commune à tous les types de sous-marin français. Le reste du temps, les sous-mariniers se forment au Centre d’entraînement de sauvetage individuel (Cesi) à l’Ile Longue dans une tour de 10 mètres. Accords avec les Etats-Unis Pour des évacuations collectives à plus de 180 mètres, la Marine nationale ne possède pas de sous-marin de sauvetage (DSRV). Les Américains, les Anglais, les Suédois et Italiens sont équipés. La France a passé des accords avec les Etats-Unis. Si nécessaire, elle peut obtenir rapidement un DSRV, transportable par avion. Un projet européen (allemand, anglais, turc, français) de construction de sous-marin de sauvetage est à l’étude. Il faut rappeler que la France n’a pas connu d’accident de sous-marin depuis la disparition du « Minerve », le 26 janvier 1968. Joël Picart
Article paru dans le Télégramme de Brest le 30 Mai 2001
 |
|
En fait, l' « Agosta » a été retiré de la flotte en février 1997, juste à l'échéance de son IPER ou période de gros travaux périodiques (un an sur un cycle de six), et conduit dans l'une des alvéoles de l'ex-base sous-marine allemande de Brest dans l'attente d'un éventuel acquéreur. Il y est en réserve, à flot, pour deux ans, assuré d'un minimum d'entretien.
L'espoir de voir naviguer sous pavillon étranger ces bâtiments-là et les deux autres encore en activité est assez sérieux. Les Agosta ont du succès au Pakistan, en Afrique du Sud, en Espagne... et sont examinés avec intérêt par d'autres pays. Ils peuvent constituer, comme « occases », des produits d'appel ou... de pesée complémentaire pour des commandes d'articles neufs conventionnels, mais perfectionnés.
Le « La Praya » est parti pour une mission commerciale de six mois en Asie (Malaisie, Indonésie, Thaïlande) avec retour à Brest le 4 avril, via l'Egypte. Le temps d'éprouver devant d'éventuels clients les particularités de ces robustes bateaux, longs de 67 mètres et d'une grande discrétion acoustique, déplaçant leurs 1.725 tonnes en plongée à 20 noeuds, pouvant descendre à moins 300 mètres et disposant d'une autonomie en combustible de 20.000 nautiques. Leurs capacités d'emploi va des torpilles 553 aux Exocet 39 anti-navires en passant par les mines.
A noter le désarmement, à l'automne prochain, de la « Psyché », dernier spécimen de la série diésel-électrique de type Daphné. Descendue de Lorient sur Toulon en 1996-97 avec la « Sirène », sa congénère (placée en réserve), elle aura servi aux essais de la torpille franco-italienne MU 90.