
LES ANECDOTES
Vieilles histoires de la vieille marine
Comment on transmet un
ordre ?
Le lieutenant du vaisseau au premier maître :
-Comme
vous devez le savoir, demain il y aura éclipse de soleil, ce qui n’arrive pas
tous les jours. Laissez monter les hommes à 8h en tenue de service sur les
passerelles et spardecks – ils pourront voir ce rare phénomène et je leur
donnerai les explications nécessaires. S’il pleut il n’y aura rien à voir ;
dans ce cas laissez les hommes dans les batteries.
Le premier maître aux seconds maîtres.
–
Sur recommandation du capitaine, demain matin à 8h, il y aura éclipse de
soleil en tenue de service. Le capitaine donnera aux spardecks et passerelles
les explications nécessaires, ce qui n’arrive pas tous les jours, s’il
pleut il n’y aura rien à voir, mais alors le rare phénomène aura lieu dans
la batterie.
Les
seconds maîtres aux quartiers-maîtres.
– Par ordre du
capitaine, à 8h ouverture de l’éclipse de soleil sur les spardecks et
passerelles en tenue de service. Le capitaine donnera dans la batterie les
explications nécessaires sur ce rare phénomène et parfois il pleut, ce qui
n’arrive pas tous les jours.
Les
quartiers-maîtres aux marins.
– Demain matin à
8h, le capitaine fera éclipser le soleil en tenue de service avec les
explications nécessaires. – Si parfois il pleut, ce rare phénomène aura
lieu dans la batterie, ce qui n’arrive pas tous les jours.
Les marins entre eux.
– Demain matin à 8h, le soleil sur les spardecks fera éclipser
le capitaine dans la batterie avec les explications nécessaire. Si parfois il
pleuvait ce rare phénomène aurait lieu en tenue de service, ce qui n’arrive
pas tous les jours.

HISTOIRES DE VIEILLES MARINES
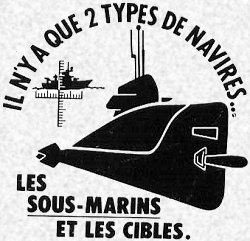
DANS LE NAUFRAGE DU « PHENIX », IL N’Y EUT QU’UN SEUL SURVIVANT : LE CHIEN, MASCOTTE DE L’ÉQUIPAGE….
Un récit de RAOUL PICAULT recueilli par MICHEL EL
BAZE.
Il y a les vivants,
Il y a les morts
Et il y a ceux qui s’en vont sur la mer.
PLATON
En ce temps-là, la magnifique flotte française comptait, entre autre navire, plus quatre-vingts sous-marins. Les plus grands de ceux –ci, dits océanique, jaugeant 1 500 t. en surface, naviguaient et opéraient toujours par paire, en s’appuyant l’un à l’autre.
Nous sommes au printemps 1939,au quai principal de la Marine à Saigon. Alors que les navires de surface qui sont là sont peints d’un beau gris perle, les deux sous-marins de l’escadre dite F.N.E.O.(Forces Navales d’Extrême-Orient), amarrés à couple, tranchent par leur longue coque noire.
Le premier à quai est l’Espoir, et collé à son flanc, son sister ship le Phenix.
L’équipage du Phenix possède une mascotte depuis plusieurs années déjà, un magnifique chien reflétant au mieux dans sa robe le caractère multiracial de l’empire français.
Pour l’instant, l’animal est permissionnaire et batifole sur le quai. Parfaitement dressé par plusieurs de ses maîtres, ce chien est un parfait sous-marinier. Il sait monter et descendre les échelles, reconnaît les diverses sonneries, et bruits du bord, connaît les emplacements qui lui sont assignés pour les repas, le sommeil, l’appareillage, la plongée et le combat. Et enfin, le nez à 40 centimètres du sol, il est plus apte que quiconque à donner l’alerte en cas de modification de l’atmosphère intérieure. Rôle tenu, sur d’autres submersibles, par des souris blanches en cage.
Il ne figure pas au rôle d’équipage, mais tous en sont d’accord, il n’est pas le moins utile.
L’appareillage
Nul ne reverra plus le Phenix et
ses quatre-vingts hommes d’équipage.
C’est la fin de l’exercice, l’Espoir fait surface normalement dans
les minutes qui suivent. A bord de l’escadre, c’est le branle-bas. Les
signaux visuels et radios s’entrecroisent.
Le sous-marin repose sur fond de sable, l’avant à 92 mètres, l’arrière
à 108, couché à 30° sur bâbord, à trois milles seulement de la cote.
A l’extérieur de la cloche, des scaphandriers accompagnent celle-ci
dans sa descente. Cent mètres constituent la limite d’action sinon de la
cloche, du moins des scaphandriers.
Au contact du bâtiment coulé, la cloche est positionnée sur le panneau
circulaire de sauvetage, et fixée de l’extérieur par les scaphandriers.
L’eau de l’étage inférieur de l’engin peut être ensuite chassée à
l’air comprimé. La cloche se trouve ventousée sur le sous-marin.
Les sauveteurs, munis de casques contre d’éventuels gaz délétères,
descendent par un sas à l’étage inférieur, et sont ainsi en mesure
d’ouvrir le panneau d’accès au submersible et alors, peut-être, recueillir
les survivants, si survivants il y a.
Car bien entendu, la survie des hommes, dans les meilleures conditions,
après un tel naufrage, ne saurait excéder quelques jours, une semaine peut-être.
Raoul
PICAULT
Texte retranscrit VIRGINIE VENTURA
Le Chien qui savait tout original
ARTICLE COMMUNIQUE PAR
JEAN MICHEL VIGEZZI
ANCIEN DE L EC FRINGUANT
BLED
N°143 d'avril 1961
En fichier joint la couverture du magazine.
Navalement
Jean Michel